Histoire du chevalier Bayard
La majorité des auteurs le font naître en 1476, suite à une déclaration approximative de Champier. Vu le déroulement de sa carrière, il est difficile d'admettre cette date ; il vaut mieux situer sa naissance en 1474 ou peut-être même en 1473. On sait peu de choses sur l'enfance du jeune Bayard ; elle s'est déroulée à Pontcharra sur cette colline de Brâme-Farine qui borde le château et qui doit son nom très probalement à la présence de loups.
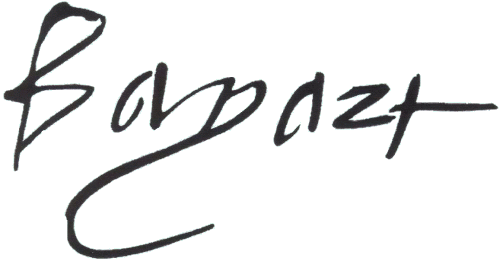
Accompagné par un lieutenant du gouverneur2, le futur chevalier quitte le giron familial le 8 avril 1486, à l'âge de 12 ou 13 ans, pour se présenter à la cour du jeune duc Charles 1er de Savoie, fixée alors temporairement au château de la Pérouse à Montmélian. Pendant 4 ans, à la cour de Savoie, résidant surtout à Turin, il apprendra la condition de page. Durant l'hiver 1486-87, le duc va attaquer son beau-frère, le marquis de Saluces, et, puisque les pages accompagnaient le seigneur, Bayard a probablement participé à cette guerre contre Saluces où il a pu servir comme estafette.
Après la mort précoce du duc en 1490, la régente Blanche, effrayée par l'état des finances, restreint le train de vie de la cour ; Pierre Terrail, surnommé Riquet puis Piquet, doit revenir à Grenoble où il est sans doute recueilli par le gouverneur Philippe de Bresse, oncle du roi de France, auquel il va le présenter. Mais c'est un autre neveu de Philippe, le jeune Louis de Luxembourg, comte de Ligny, qui prendra Bayard à son service. Il semble que le page aille poursuivre alors sa formation guerrière en Picardie – autre zone frontière – auprès du capitaine Louis d'Ars, commandant les troupes de Ligny.

L'année suivante, Pierre Terrail rejoint le Dauphiné pour y régler la succession de son père ; selon certains auteurs, il serait alors devenu seigneur de Bayard.
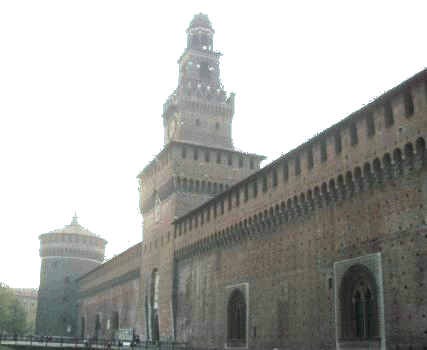
En avril, par suite d'une défection de son contingent suisse, Ludovic est fait prisonnier (il sera enfermé pendant 10 ans, jusqu'à sa mort, à Loches ; ce traitement peu chevaleresque fait douter de la réalité de l'épisode précédent). Les Français soumettent tout le Milanais et une troupe, dont celle de Ligny, reste en garnison à Milan. Bayard est nommé peu après guidon de la compagnie ; c'est son premier grade militaire. Bien qu'il se produisent quelques escarmouches, commence alors une période de répit et, selon certains auteurs, c'est peut-être là qu'aurait été conçue Jeanne Terrail, la fille naturelle de Bayard.

En octobre 1503, l'armée, après la défaite de Cérignola, se replie sur les bords du Garigliano, au nord de Naples ; là, sur un pont de bateaux, Bayard a tenu tête seul face à 200 Espagnols. Cette action d'éclat, entrée dans la légende, porte à son comble la réputation de Bayard [Cependant, Guichardin ne dit pas un mot de Bayard dans les cinq pages qu'il consacre à la bataille du Garigliano]. Mais l'armée française capitule à Gaëte. Louis XII signe une trêve avec l'Espagne, abandonne Naples, mais conserve le Milanais.
En 1507, le roi part réprimer une révolte à Gênes. Bayard, qui a quelques problèmes de santé et se faisait soigner à Lyon, se joint malgré tout à l'expédition. Il se distingue dans la prise du bastillon où il attaque au premier rang ; le lendemain, Gênes capitule et Louis XII y entre victorieux. Deux ans plus tard, selon certains auteurs, le roi nomme Bayard capitaine et lui confie une compagnie de gens d'armes (30 lances4 et une unité d'infanterie).
Louis XII, Maximilien d'Autriche et le pape Jules II s'allient pour déclarer la guerre à la république de Venise qui étend démesurément ses possessions. Les hostilités s'ouvrent en mai 1509 par une éblouissante victoire française à Agnadel ; les Français occupent Vérone et une partie du Frioul. Les Vénitiens se ressaisissent, reprennent Padoue et cherchent à désagréger l'alliance ennemie. Maximilien se retire du conflit ; puis en 1510, Jules II se retourne contre la France, entraînant avec lui, dans la Sainte Ligue, les mercenaires suisses qui, pendant cinq ans, refuseront leurs services au roi de France. C'est le début du déclin de la puissance française dans le Milanais.
En 1512, Gaston de Foix et Bayard font reculer le pape et dégagent Ferrare, puis occupent Bologne. Bayard marche sur Brescia, alors aux mains des Vénitiens, il est grièvement blessé au cours de l'attaque de la ville ; transporté chez de riches bourgeois, il protégera l'honneur de ses hôtes, sauvera leur maison du pillage et même distribuera à leurs filles l'argent remis par ses hôtes en remerciement de sa protection.
A peine guéri, il rejoint Gaston de Foix devant Ravenne pour participer à une victoire éclatante et coûteuse, où Gaston de Foix trouve la mort (1512). Dans un combat autour de Pavie, Bayard est à nouveau blessé ; il rentre se faire soigner à Grenoble. L'armée, épuisée, revient en France. Bayard va combattre ensuite en Navarre, puis en Picardie contre Henry VIII d'Angleterre qui a envahi la France. Il sera une seconde fois fait prisonnier à Guinegatte (1513, bataille peu glorieuse dite journée des éperons), mais sera libéré contre une rançon payée par Louis XII.
En 1514, le pape Léon X succède à Jules II. Venise redevient l'alliée de la France. Mais c'est une année triste pour la cour de France, où séjourne alors Bayard. Anne de Bretagne meurt à 38 ans, sans avoir donné de successeur au roi. Louis XII se remarie avec la fille du roi d'Angleterre, Marie Tudor. Elle a 18 ans, lui 52 et il meurt trois mois plus tard, le 1er janvier 1515.
Le nouveau roi est décidé à reconquérir le duché de Milan. Mais les Suisses bloquent les cols nordiques, les plus accessibles, dont celui du Mont-Genèvre. En août, Bayard est chargé de préparer le passage des Alpes par un col haut-alpin, plus méridional. On ne sait pas s'il est passé avec quatre compagnies par le Queyras (le col de La Croix , le col Agnel – collem Agni – selon Rivail ou par l'Ubaye (le col Maurin) à plus de 2600 m d'altitude, mais leur traversée n'a pas été éventée par les armées gardant le marquisat de Saluces : à Villafranca, la petite troupe française surprend et fait prisonnier en plein banquet le capitaine papal Prosper Colonna et ses cavaliers. Quant au gros de l'armée française, elle passe par le col de Larche en Ubaye où elle aménage une route ; elle évitera ainsi les garnisons suisses dont une partie s'enfuit, libérant le Mont-Genèvre, où passera alors l'artillerie lourde.

En ce mois de septembre, François Ier signera avec les Suisses un traité de paix qui, malgré son coût élevé, devait s'avérer définitif.
On trouvera, page 1515, une relation plus détaillée de cette expédition vers Milan.

On connaît mal cette facette de l'œuvre de Bayard ; Champier n'en parle pas, peut-être à cause de la partialité de ses sources ou de sa trop grande précipitation dans l'écriture de son livre. Les premières informations sur le sujet semblent être données dans le livre d'Expilly ; on en trouvera aussi dans celui Camille Monnet5, dans les actes des Rencontres Bayard de 1997 et dans Histoires croisées (article de Georges Salamand).
La peste est le principal fléau auquel Bayard a été confronté. Elle sévissait épisodiquement depuis 1348, était très contagieuse et provoquait beaucoup de décès. Bayard dut prendre des mesures pour restreindre la contagion (isolement des malades, restrictions de circulation ...) et assurer des soins corrects aux pestiférés grâce à une réquisition de médecins. C'est en 1520 que sévit l'épidémie la plus violente de l'histoire du Dauphiné.
Il s'est attaché également à limiter les effets des inondations du Drac, qui faisaient périodiquement le malheur de Grenoble. On sait qu'il n'a pu hélas y apporter de solutions définitives, pas plus d'ailleurs que Lesdiguières ne le fera un siècle plus tard. C'est seulement sous Louis XIV que le Dragon sera à peu près maîtrisé.
Bayard eut à défendre sa province contre des bandes de brigands qui profitaient des catastrophes pour piller la région. On sait par exemple qu'il a défait une bande à Moirans en mai 1523. Il poursuit également les spéculateurs qui opprimaient le peuple dans les mêmes circonstances.
Le témoignage majeur sur la qualité de son activité administrative est fourni par la piété et la douleur de la foule nombreuse assistant à ses funérailles – dont Champier dit qu'elles furent dignes d'un prince –. En effet, Bayard s'était fortement impliqué dans l'aide aux deshérités, aux malades, aux pestiférés et même aux prisonniers, exigeant que tous soient correctement traités et nourris. Il n'hésitait pas à couvrir les frais de cette assistance en payant de sa poche. A propos de son action humanitaire, nombre d'historiens font remarquer que Bayard n'a pas été beaucoup aidé par son cousin l'évêque, bien moins compatissant que lui à la misère humaine, particulièrement imbu de sa fonction et plein de mépris pour les consuls. Bayard aura, au moins une fois, à tempérer ses extravagances. C'est pourtant ce cousin qui sera à l'origine du livre de Champier, d'où nos soupçons sur son impartialité.
Bonnivet est blessé et l'armée française, peu motivée, entame une retraite prudente : elle rejoint Novare le 8 avril 1524, traverse la Sesia à Romagnano et, le 29 au soir, bivouaque près de Rovasenda. Le lendemain matin, l'armée repart. Bayard, à l'arrière-garde, est assailli par des cavaliers ennemis ; vers midi, il reçoit un coup d'escopette au flanc droit ; descendu de cheval, il est fait prisonnier. On le dépose au pied d'un arbre : il est visiblement touché à mort. Selon Champier, les chefs ennemis viennent à son chevet et lui manifestent leur compassion. Au duc de Bourbon venu le plaindre, il aurait répondu fièrement (selon du Bellay) : monsieur, il n'y a point de pitié pour moy, car je meurs en homme de bien, mais j'ay pitié de vous, de vous voir servir contre votre prince, votre patrie et votre serment.
Bayard meurt le 30 avril 1524, près de Rovasenda. Il a été pleuré sincèrement par les Français et par les Espagnols, qui, selon la tradition, auraient fait dire pour lui une messe à Roasio dans la chapelle de la Madonna dei Cerniori.
Ramené à Grenoble le 20 mai, il a été inhumé le 26 août dans la chapelle du couvent des Minimes de la Plaine à Saint-Martin-d'Hères. Une incroyable série de fausses manœuvres, tant au 19e avec le préfet d'Haussez qu'au 20e siècle sous l'occupation allemande, ont abouti à la disparition probablement définitive des restes de Bayard. A la collégiale Saint-André de Grenoble se trouve un mausolée funéraire que la Restauration a élevé à sa mémoire ; sur la place du même nom, on trouve une statue sculptée par Raggi. A Pontcharra, sa ville natale, une statue équestre porte son regard vers le château de ses ancêtres.
Remarquons ici que 1473, année possible pour la naissance de Bayard, est aussi celle de Copernic ; cette date marque bien le début de la Renaissance, le début d'une nouvelle civilisation.
2. Le Loyal serviteur écrit que Bayard était conduit par son oncle évêque, ce que contredisent les archives de Savoie, qui attestent que Bayard n'était accompagné que d'un noble dauphinois. Le gouverneur du Dauphiné, Philippe de Bresse, oncle du duc et auparavant régent de Savoie, avait certainement beaucoup plus d'influence à la cour que l'évêque. Les relations entre l'évêque de Grenoble et les Savoyards – le duc et les curés du décanat de Chambéry – ont rarement été bonnes, les Savoyards n'appréciant pas l'ingérence du coprince d'un Etat pour le moins étranger et souvent ennemi. Ils ont cherché plusieurs fois à se défaire de cette tutelle (sous Yolande, sous Charles III, ..., voir le livre de Joseph-Antoine Besson, pp. 310 et sq., Mémoires pour l'histoire ecclésiastique des diocèses de Genève,... et du décanat de Savoie, 1759 [Google books].
On voudra bien noter également que le dit gouverneur, Philippe de Bresse, était également oncle par alliance de la duchesse. Blanche était en effet fille de Guillaume de Montferrat et de Bernarde de Brosse, sœur cadette de Claudine de Brosse, épouse de Philippe. Retour
3. Ce que ne confirment pas du tout les propos de l'historien italien Guichardin, pourtant très prolixe. Retour
4. Une lance, a cette époque, est un groupe de combat comprenant l'homme d'armes, cavalier lourdement armé, 3 ou 4 archers à cheval, quelques combattants à leur service, fantassins ou cavaliers et parfois un page. Retour
5. La première étude sérieuse connue semble être celle de Jacques Chevalier (Bull. Ac. Delph., 16 mai 1924). Retour