|
Son mouvement entre vite en conflit avec l'évêque, surtout parce qu'il proclamait que tout le monde pouvait prêcher. Sa doctrine n'est pourtant pas très différente de celle, presque concomitante, de François d'Assise (1182-1226). Mais Valdès critiquait trop le luxe et le train de vie du clergé. Les Vaudois seront chassés de Lyon par l'évêque, condamnés par le concile de Latran III, puis excommuniés par celui de Vérone (1184).
Ils seront alors persécutés et se réfugieront dans les vallées dauphinoises (les escartons), dans le Lubéron (1470), le Bugey et dans toutes les Alpes, en particulier sur leur versant est. C'étaient d'abord de modestes ouvriers agricoles, puis, avec le temps, ils pratiqueront tous les métiers ruraux pour former des communautés souvent autonomes, parce que persécutées.
| 
|
| Valdès avait fait traduire la Bible en franco-provençal à ses frais et fait faire de nombreuses copies de ce texte, alors qu'une telle traduction était interdite par l'Eglise. Les mœurs des Vaudois étaient très pacifiques : intègres, altruistes, travailleurs, mutualistes. Ils déniaient le droit à la peine de mort et refusaient de prêter serment. | 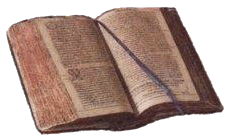
|
Cependant, d'après JJ. Pilot (Histoire de Grenoble, 1829, p. 114) Louis XII avait, en octobre 1501, ordonné l'arrêt des persécutions contre les Vaudois et la restitution de leurs biens. C'est sans doute en l'honneur de ce roi (ou de Louis XI) que le village de Valpute (mauvaise vallée) a pris le nom de Vallouise. On constate qu'ensuite François Ier n'avait pas eu la tolérance de son prédécesseur.
Remarquons ici la très belle figure de Sébastien Castillon (1515-1563), issu du terreau vaudois (selon Ferdinand Buisson, op. cit., tome 1, p. 6 et ss.). C'est Castillon, né près de Nantua et contemporain de Champier, qui a écrit cette phrase toujours d'actualité : tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme. C'était une réponse aux crimes de l'Inquisition et à l'immolation de Michel Servet par Calvin en 1553. Elle est tout à fait dans la philosophie vaudoise.
En 1532, les Vaudois s'étaient résignés à adhérer à l'Eglise protestante, bien qu'ils fussent loin de partager son idéologie, pas plus celle de Calvin que celle de Luther, qui avait soutenu la répression féroce d'une révolte des paysans allemands en 1524-25.
Rappelons qu'on peut faire remonter la naissance de la Réforme à 1517, date de la publication des 95 thèses de Luther ou à 1521, date de son excommunication par le pape.

Des ducs de Savoie ont combattu les Vaudois, comme Charles-Emmanuel en avril 1655 au cours d'une croisade avec 40 000 soldats, sous les ordres du marquis de Pianezza (ce sera les Pâques vaudoises). Il ne restait alors dans les Alpes que trois communautés, dont celle de Val Pellice.
Les Savoyards ont voulu les exterminer, malgré leur résistance désespérée menée sous la conduite de leur héros Josué Janavel ; les soldats déploieront à leur encontre les pires atrocités. Une partie des Vaudois s'enfuit en Queyras par le col Lacroix, mais la majorité des rescapés émigrera en Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Amérique et Afrique du sud, comme d'ailleurs les protestants de France, persécutés à la même époque et menacés de mort par Louis XIV et Louvois (dragonnades, 1680, révocation de l'édit de Nantes 1685).
| C'est seulement le 17 février 1848 que le royaume de Piémont, devenu enfin tolérant, accorde aux Vaudois les droits civiques et la liberté religieuse. La fête des libertés commémore tous les ans cette date. Cette confession s'appelle maintenant la Table vaudoise. Son centre est Torre Pellice. Elle est présidée par un modérateur – actuellement une modératrice – et compte environ 30 000 adeptes en Piémont, en France et en Amérique latine. Ses pasteurs s'appellent des barbes (ou oncles). | 
|
Notes
2 - Cf. Pierrette Paravy : Bayard et le monde religieux de son temps, p. 63, Rencontres Bayard 1997, Grenoble. Retour
3 - Cf. Ferdinand Buisson, Sébastien Castellion, sa vie, son œuvre (1892), tome 1, page 77. Deux ans plus tard, sur son lit de mort, François Ier aurait regretté cette atrocité et demandé à son fils la punition de ses auteurs. En fait, en matière de religion, François Ier fut un roi indécis, partagé entre l'influence de son ami d'enfance, le très sectaire Anne de Montmorency, et celle de son entourage féminin, tolérant et humaniste, comme sa sœur Marguerite d'Alençon ou sa belle-sœur Renée de France. Retour
4 - Voir par exemple Bernard Bligny in Histoire des diocèses de France , vol. 12, Grenoble, p. 97, éd. Beauchesne, 1979. Retour